
SAMEDI 18 OCTOBRE
Le public peut assister gratuitement à des conférences présentées par un spécialiste du monde de l’archéologie : archéologue, conservateur, restaurateur, scénographe, plasticien…
Palais-Musée des archevêques – Salle des synodes
Entrée libre
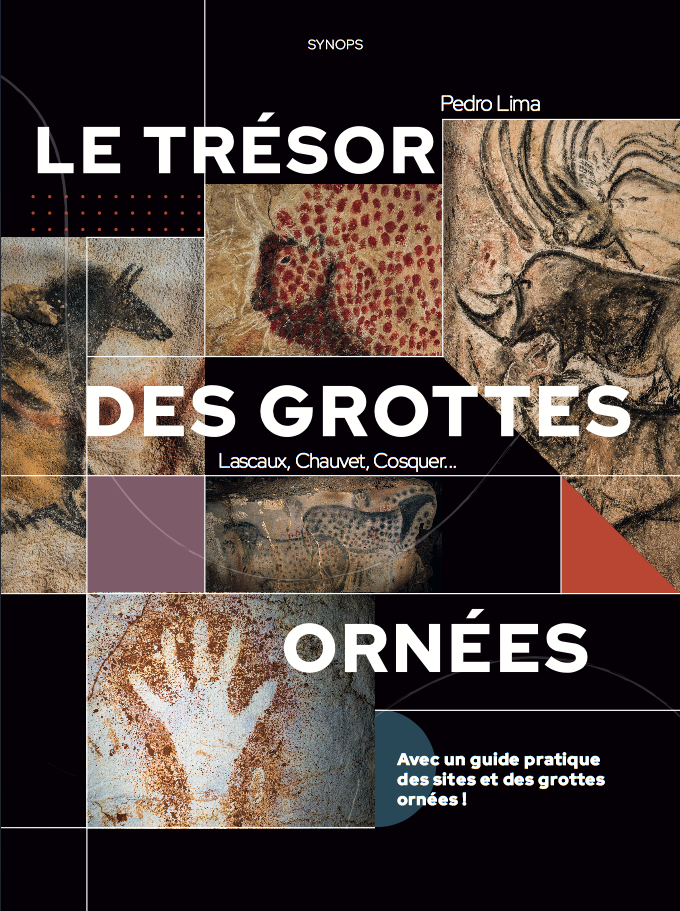
Le trésor des grottes ornées
Pedro LIMA, journaliste scientifique et auteur
14H00
En France, il existe 200 grottes et abris ornés, sur les 400 répertoriés en Europe. Lascaux, Chauvet et Cosquer, bien-sûr, mais aussi Font-de-Gaume, Pech-Merle, Niaux, Isturitz, Arcy-sur-Cure, Rouffignac ou Altamira (Espagne)… Comment ont-elles été découvertes ? Quelles étaient les techniques des artistes? Pourquoi ont-ils peint et gravé des milliers d’animaux sur les parois? La conférence, magnifiquement illustrée d’images des grottes originales, dévoile pour un large public les secrets, les hypothèses et la beauté de l’art pariétal paléolithique. À partir des informations issues des cavités ornées (dès la découverte d’Altamira en 1879), et des sites qui leur sont associés, c’est une nouvelle image des sociétés de chasseurs collecteurs qui se révèle, loin des idées reçues.

De la grotte Chauvet au site Grotte Chauvet 2-Ardèche : 30 ans de valorisation du 1er grand chef d’œuvre de l’Humanité.
Valérie Molès, Docteure en Préhistoire – Responsable Médiation culturelle, pédagogique et scientifique à la Grotte Chauvet 2-Ardèche Responsable culturelle préhistoire Société Kléber Rossillon
15h00
2024 est une année anniversaire avec les 30 ans de la découverte et les 10 ans d’inscription sur liste du patrimoine mondial de l’humanité. Retour sur une découverte qui a bouleversé les connaissances en Préhistoire et mobilisé scientifiques, politiques, ingénérie pour réaliser la plus grande réplique de grotte ornée du monde. Depuis 2015, le site « Grotte Chauvet 2- Ardèche » permet à tous de connaitre ce patrimoine et de partager la culture scientifique en Préhistoire grâce à une programmation variée et sur toute l’année. Plus de 3,5 millions de visiteurs ont déjà été accueillis…

Grands sites du Maroc médiéval et archéologie préventive
Ahmed S. Ettahiri, Professeur, INSAP
Abdallah Fili, Professeur, Université
Chouaib Doukkali Sébastien Gaime, directeur adjoint scientifique et technique auvergne, INRAP
Jean-Pierre Van Staëvel, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
16h00
La mission archéologique franco-marocaine « Sanctuaires et forteresses almohades » s’attache à explorer certains des sites emblématiques du Maroc des XIIe et XIIIe siècles. Elle est ainsi nommée en référence aux premières études consacrées, dans les années 1920, aux spectaculaires réalisations monumentales du plus grand empire que l’Occident musulman médiéval ait connu : l’Empire almohade (1147-1269). A l’automne 2022, la mission archéologique s’est enfin tournée vers le Haut-Atlas et le site de Tinmal (province de Marrakech), célèbre cité sainte et sanctuaire dynastique de l’Empire almohade. Réalisée avec l’autorisation de la direction de l’INSAP en vue de l’établissement d’un pré-projet de partenariat scientifique, la campagne avait pour objectif de poser les bases d’une future intervention de type préventif, en amont des travaux de restauration de la muraille médiévale. La mission archéologique « Sanctuaires et forteresses almohades » est placée sous la tutelle de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP, Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Rabat) et de la Casa de Velázquez (Madrid). Elle bénéficie de la coopération de l’Université Chouaib Doukkali d’El-Jadida et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’INRAP et de l’UMR 8167 Orient & Méditerranée, et du soutien de la Commission des fouilles du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
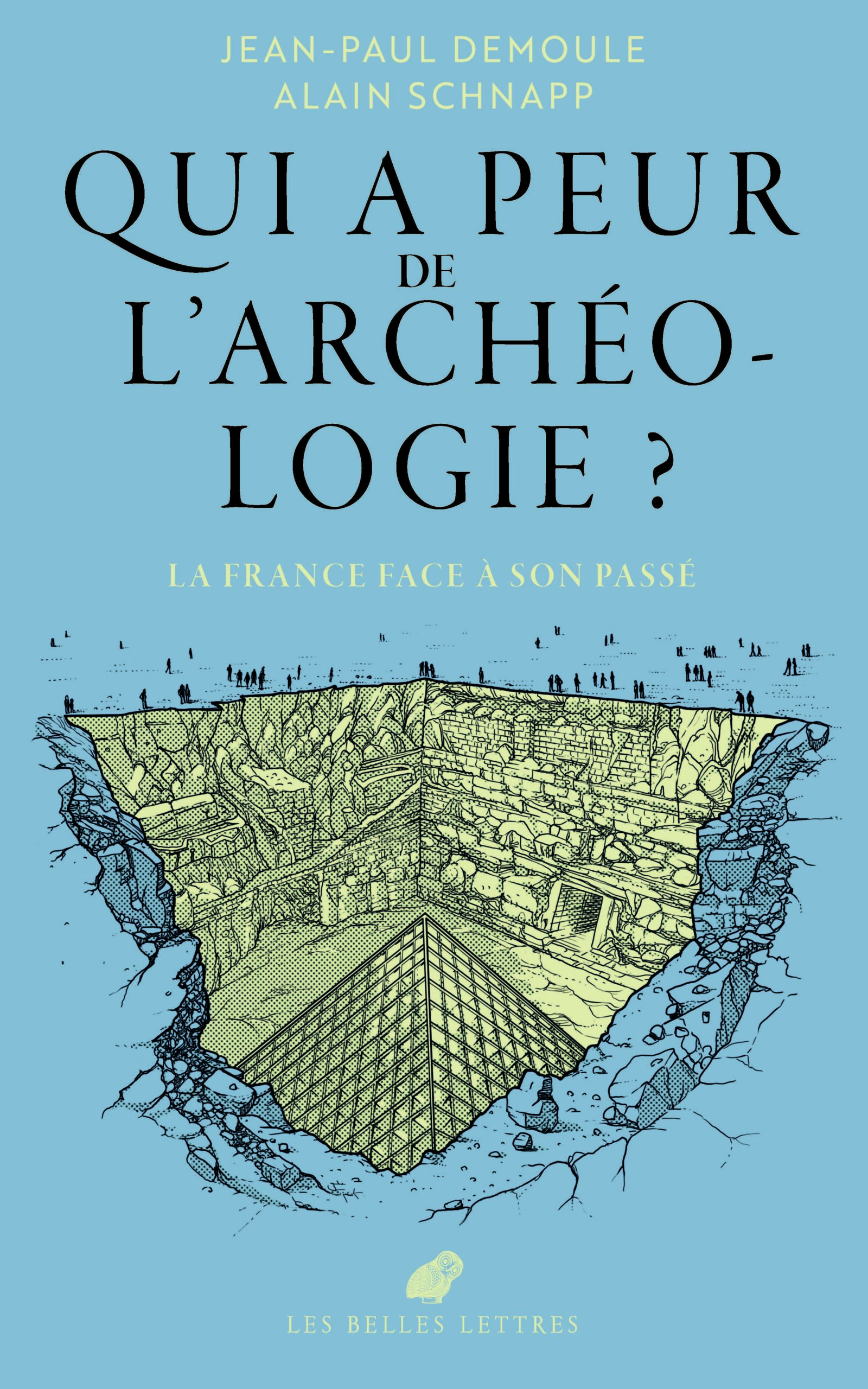
Qui a peur de l’archéologie ? La France face à son passé
Jean-Paul Demoule,professeur émérite d’archéologie à l’Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, membre honoraire de l’Institut universitaire de France et ancien président de l’Inrap.
17h
Vous aurez beau arpenter les moindres recoins des fabuleuses collections du Musée du Louvre, joyau de la capitale et de la culture françaises, vous n’y verrez presque aucun objet archéologique mis au jour en France. Tous, dont des splendeurs, sont délaissés au Musée de Saint-Germain-en-Laye, attendant dans l’ombre, des crédits, du public, voire un président qui s’emparerait du lieu pour en faire son « grand projet ». Pourquoi un tel déni institutionnel, donc institutionnalisé, vis-à-vis de notre patrimoine ?
Certes, c’est un travers bien humain qui consiste à toujours regarder ailleurs plutôt que de baisser les yeux pour fouiller sous ses pieds. Déjà, au deuxième siècle de notre ère, l’écrivain voyageur Pausanias, autant historien que géographe, écrivait que les Grecs montraient « plus de talent à admirer ce qui provient de l’étranger que ce qui se trouve chez eux, en sorte que si les meilleurs de leurs érudits ont analysé dans le moindre détail les pyramides des Égyptiens, ils n’ont pas accordé le moindre souvenir au Trésor de Minyas ou aux murs de Tirynthe, qui ne sont en rien moins admirables » (Béotie, IX, XXXVI, 5).